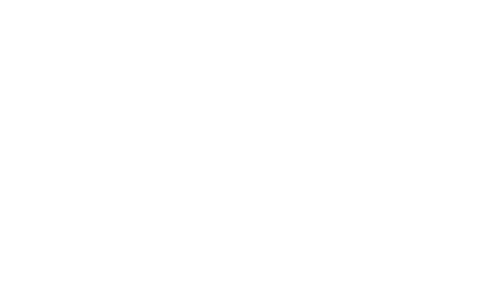Analyse d’un discours éducatif féminin

Les recherches archivistiques effectuées dans le cadre de notre travail sous la direction conjointe du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation et de l’université Lyon 2, nous ont amenés à consulter de nombreux manuels scolaires dédiés à l’éducation des jeunes filles datant du début de la Seconde Guerre mondiale. L’éducation « féminine » que nous avons pu découvrir, ou redécouvrir, dans ces ouvrages scolaires, illustre quelques interrogations sur le paradoxe entre une histoire des femmes en guerre plutôt progressiste et une volonté éducative de maintenir la femme dans sa place genrée. La question de la relation entre la guerre et ce que l’on peut appeler le « genre féminin » se concentre souvent autour de l’effectivité, ou non, d’une émancipation féminine due à un rapprochement des statuts. Cependant, qu'en est-il d’une séparation homme-femme institutionnalisée et dans une volonté de subordonner celle-ci ?
- Féminité et assignation
L’étude des manuels d’éducation à travers l’Histoire nous rend compte de la volonté institutionnel d’ordonner la société et plus largement le monde tant dans son caractère tangible que dans ses représentations et ses imaginaires. Les femmes, comme tout objet d'étude socialement construit, sont donc pensées à partir de la place qui leur est accordée. Dans les apprentissages portés par ces manuels d’enseignements ménagers du début des années 40, la jeune fille (et donc la future femme-épouse-mère) oscille entre deux concepts : le « savoir-faire » et le « savoir-être ».
La première phase de transformation de l’enseignement ménager passe par la scientifisation du travail domestique. « Donner aux fillettes de onze à quatorze ans, outres les techniques et les habitudes requises d’une bonne ménagère, les principes scientifiques qui expliquent et justifient ces techniques et ces habitudes » devient la maxime de nombreuses préfaces de manuels. Il y a tout d’abord différenciation entre le travail des femmes et des hommes qui, avant d’être reconnus inégalement, ne concerne pas les mêmes apprentissages. L’apprentissage genré est la première étape dans le processus scolaire qui mène au travail genré et donc à une distinction sociale future. Le « savoir-faire féminin » s’institutionnalise et s’homogénéifie par la mise en place de programmes explicitant la nécessité d’allier habitude, science et valorisation sociale et personnelle. De ce fait, on classe, schématise, mathématise et ordonne les manières de faire et les objets du quotidien.
Si savoir comment gérer l’économie domestique constitue une étape incontournable de l’apprentissage des jeunes filles, une posture de la femme idéale et vertueuse se dessine au fil des enseignements. Façonner le caractère est un enjeu dans une société qui s’organise sur la différence des sexes et de leurs naturalités. La femme, dans l’objectif maternel qui lui incombe, est souvent décrite comme devant être « douce » et « ferme » à la fois ou encore « à l’écoute » et « décisionnaire ». On ne ne néglige pas le comportement de la future femme car même si elle sera assignée au travail domestique, celui-ci n’est pas dépourvu d’importance. Le « rôle » de gardienne du foyer, réservé au genre féminin, est la pierre angulaire de deux entités mises sur un piédestal par Vichy : la famille et l’encadrement de la jeunesse.
- Guerre et genre
La guerre, dans sa capacité de destruction et reconstruction d’une partie de l’ordre social, est souvent un moment de renouveau. Contrairement à l’idée reçue véhiculée par la mise en avant de la guerre comme libératrice du genre féminin, la Seconde Guerre mondiale n’a pas déconstruit en profondeur la division genrée des espaces sociaux et du travail. Durant cet événement totalisant qui redéfinit les catégories, peut se poser la question : quelle nouvelle place et quels nouveaux enjeux pour les femmes ?
Si la promotion de la femme comme pilier de la société dans les manuels laisse transparaître une volonté d’un maintien de l’ordre social endogène quand le pays est engagé dans une lutte exogène, d’autres politiques – comme celle nataliste – peuvent s’inscrire dans une politique d’économie de guerre. Dans les programmes et donc, par ruissellement, dans les manuels, le devoir de natalité prend une place prépondérante. Outre les cours spécifiques sur les devoirs des mères tels l’allaitement, l’hygiène du bébé ou les maladies infantiles, un discours construit sur les bienfaits d’enfanter est mis en exergue. La notion de « dépeuplement » et « repeuplement » tient une place importante dans les objectifs des programmes. Cette concentration des efforts sur la question nataliste peut s’expliquer par le contexte de dérèglement de la balance démographique causé par le conflit mondial. La future « mère » devient donc un enjeu national et son éducation une question de conservation d’un ordre précaire.
L’institution, en prise avec le processus collaborationniste, ne cherche donc pas à maintenir l’ordre par la redéfinition des catégories mais par la confirmation de rôles naturalisés qui changent juste du fait l’importance qui leur est donnée. Si les femmes n’ont pas la possibilité de s’émanciper, leur « rôle » gagne en légitimité.
Les pédagogies nouvelles : la question de l’éducation et de la paix dans les apprentissages

Lors de notre partenariat avec le CHRD différentes thématiques ont été abordées, notamment celle de l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons durant l'entre-deux-guerres.
En temps de conflit la vision antagoniste de la paix fait figure de stratégie de lutte et notamment dans l’école républicaine. Cependant, la question de la guerre ne peut se dissocier de la question de la paix. On constate, durant l'entre deux guerres, un renouveau de l’intérêt pour l’éducation en rapport avec une très forte identité européenne. En ce sens, il était urgent pour l’éducation nouvelle de lier la problématique de la paix à l’éducation afin de « produire » des citoyens exemplaires.
- Les nouveaux enjeux de l’éducation nouvelle
Les pédagogies nouvelles s’inscrivent dans un renversement des valeurs de l’éducation traditionnelle. En effet, la manière d’enseigner tente de prendre en compte l’individu dans son entièreté en s’éloignant des systèmes normatifs d’enseignement. Il s’agit de comprendre l’enfant, d’interpréter ses attitudes ainsi que de l’aider à développer tout son potentiel. L’enfant est alors un sujet libre et autonome.
Comme on peut l’entendre dans l’émission diffusée sur France Culture :
« Au lendemain de la Première guerre mondiale, dans une Europe traumatisée, des pédagogues d’un nouveau genre forment le projet révolutionnaire de changer le monde en changeant l’école. »
L’idée d’enseigner d’une autre manière date au moins de la Renaissance. Cependant c’est surtout à partir de la fin du XIXe siècle que des enseignants, médecins, psychologues ou philosophes s’engagent vers un nouveau modèle d’école.
Ainsi de nombreuses écoles expérimentales voient le jour. Il s’agit de proposer aux enfants des activités telles que la menuiserie, la couture ou la cuisine. Les enfants « apprennent en faisant » comme le formule John Dewey en 1894. On favorise également le développement de l’expression artistique : dessin, danse, sculpture, chant, poésie, langage gestuel, cris, théâtre, musique, afin de mettre en œuvre leur liberté d’expression. L’importance de la vie au grand air est également de rigueur au sein de ces nouveaux établissements scolaires.
A Calais, en 1921, soit seulement trois ans après la Première Guerre mondiale se tient le premier congrès international de l’éducation nouvelle. Les pédagogues réunies s’interrogent et remettent en question les façons d’enseigner et non les capacités des enfants. En effet, il s’agit de prendre en compte le plaisir d’apprendre, l’importance de la pluridisciplinarité, le respect des rythmes de l’enfant et sa responsabilisation en tant qu’individu libre.
En ce sens, des formations sont mises en place dès 1922 afin de permettre de répondre aux besoins des praticiens qui sont constamment dans une attitude réflexive et dans un renouvellement perpétuel.
- Des approches pédagogiques différentes
On constate tout d’abord quelques divergences d’ordre pédagogique. Par exemple Ovide Decroly désire que l’enfant apprenne globalement et met en place une démarche d’apprentissage en trois temps (observation, analyse et expression), Maria Montessori insiste sur le respect du libre choix des enfants, quant à Célestin Freinet, il met en avant le rôle de la motivation.
On note également des avis différents quant au rôle de l’adulte. Alexander Neill considère que les adultes doivent exercer le moins de contraintes possibles sur les enfants, alors que d’autres pédagogues expliquent qu’il est important pour les enfants d’avoir un cadre imposant certaines limites.
De même on constate un certain clivage politique. Certains veulent ouvrir des écoles nouvelles publiques et gratuites destinées aux enfants issus des milieux populaires (Sébastien Faure, Célestin Freinet…), d’autres en revanche conçoivent des écoles privées et chères réservées à des catégories sociales plus privilégiées.
Néanmoins, ils sont tous en accord sur le fait qu’il est urgent de « créer » un individu pacifiste, solidaire et qui aura la notion du partage.
Alexander Sutherland Neill, pédagogue libertaire écossais et fondateur, en 1921, de l'école de Summerhill qu'il « dirigea » jusqu'à sa mort est connu pour son radicalisme à l’égard de l’école traditionnelle. Il justifiera cette aversion en tenant ces propos :
« C’est sur les conseils du démon que l’on inventa l’école ; l’enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes ; l’enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu’elle n’eut aucun but ; il aime manier les objets, on le mit en contact avec les seules idées ; il voudrait s’enthousiasmer, on inventa les punitions ; alors les enfants apprirent ce qu’ils n’auraient jamais appris sans l’école : ils surent dissimuler, ils surent tricher, ils surent mentir. »
Ces propos catégoriques réaffirment ce que défendent des opposants à ces pédagogies alternatives, à savoir le manque de rigueur ou la trop grande liberté des enfants.
- Conclusions
Le choc de la Première Guerre mondiale a fortement influencé les pédagogues dans la conception de ces nouvelles méthodes d’éducation. L’importance de la participation active des enfants ainsi que la libre expression des individus fait partie intégrante de ces nouvelles techniques d’apprentissage. A la Libération, l’éducation nouvelle est à la mode ; certaines de ses pratiques se sont généralisées de nos jours que ce soit par les « classes vertes » ou les travaux manuels notamment avec l’éducation artistique surtout privilégiée pendant l’école primaire.
Durant l’Entre-deux-guerres, il était primordial pour ces éducateurs de sensibiliser l’opinion internationale face aux enjeux de l’éducation et notamment d’intégrer aux valeurs éducatives une « culture de la paix » dès les premières années de la vie des enfants.
Sources
- ANNEBEAU J., 2004,, "La problématique de l'éducation à la paix de deux représentants de l'éducation nouvelle : Célestin Freinet et Maria Montessori" , thèse préparé à l'Université Lumière Lyon II
- La Fabrique de l'Histoire, « Pédagogies nouvelles (1/4) Où en est l'éducation nouvelle aujourd'hui ? » 21/11/17. Ecouté le 24 mars 2018
- VIAUD. M.-L., « Montessori, Freinet, Steiner…une école différente pour mon enfant ? Le guide des pédagogies et des établissements, de la maternelle au lycée », Editions Nathan, 2008
La mémoire construite :entre remémoration et oubli
"La vie a perdu contre la mort, mais la mémoire gagne dans son combat contre le néant."
Tzvetan Todorov à propos du Mémorial des déportés juifs en France

- De quoi parlons-nous ?
La mémoire, vaste sujet, est un outil politique puissant. Obligatoirement construite afin d’être utilisée pour revendiquer un territoire, une identité, un passé, une souffrance, elle n’est plus seulement une arme pour la création d’un nationalisme, mais elle se voit devenir un objet de connaissance, qui permettra d’éventuelles analogies avec nos crises actuelles afin d’en éviter le pire et surtout d’en apprendre le plus.
Depuis la fin des guerres du XXème siècle, la mémoire prend une place importante dans les discours politiques et sociaux. Ce besoin d'en appeler « devoir de mémoire », pour éviter une horreur telle que les Première et Seconde Guerres mondiales, ne cesse de grandir jusqu’à atteindre un point culminant, aujourd’hui. En effet, avec la disparition des derniers témoins, il devient encore plus important de parler de cet événement. Cette urgence peut se lire dans le besoin de recueillir le plus de témoignages possibles, afin de conserver le plus de récits de vie possible, mais elle se lit aussi dans la façon dont les professeurs au collège et au lycée vont aborder le sujet, en nous pressant de parler à nos aïeux dans l’espoir que cela nous sensibilise assez pour ne pas reproduire les horreurs passées.
Si parler de la mémoire est une épreuve et un devoir, pour reprendre l’expression « devoir de mémoire », nous devrions surtout penser au devoir de comprendre les constructions de la mémoire et ses utilisations.
Nous tenterons ici d’examiner ce que recouvre la notion de « mémoire » en invitant le rédacteur du texte et ses lecteurs à s’interroger plus profondément sur cette question. Nous n’avons, du coup, aucune prétention à répondre aux grandes problématiques que pose la mémoire, ou bien même d’en donner une explication exhaustive.
- Comprendre la notion de mémoire
Qu’est-ce que nous appelons « mémoire » ? Qu’est-ce que l’on entend par ce terme fourre-tout, imprécis, qui veut en dire beaucoup mais termine par ne plus rien raconter ? La mémoire, terme riche, peut signifier beaucoup, dire beaucoup, mais aussi faire taire et forcer au silence. De nombreux chercheurs ont travaillé sur cette notion, notamment des historiens oui, mais pas que. Les philosophes ont beaucoup pensé cette question, étant d’abord amené à réfléchir sur l’identité, l’appartenance, le souvenir, l’histoire. Et c’est à partir de ce dernier que Paul Ricœur va commencer à questionner ce terme, en traversant aussi la notion de l’oubli. C’est donc dans son ouvrage « La mémoire, l’histoire, l’oubli », que ce philosophe émérite nous propose de comprendre l’articulation de ces trois entités, qui sont tout sauf disparates. Cantonné à comprendre comment nous choisissons de représenter le passé, il passera par des notions comme celle de « devoir de mémoire », « d’abus d’oubli » et « d’abus de mémoire ».
Pour Ricœu, la mémoire est tout d’abord individuelle et va devenir collective une fois que l’analogie entre les vécus sera faite, et que celle-ci sera passée par les mêmes processus : le souvenir et le deuil. Quand elle est individuelle, elle nous permet de constituer ce qu’on appelle notre identité, modelant alors notre comportement par rapport à un passé propre et personnel. Mais quand ces mémoires individuelles sont communiquées et que les protagonistes trouvent des similitudes, des ressemblances, des douleurs communes, ils se réunissent pour former ce que l’on peut appeler une « mémoire collective ». C’est-à-dire un passé remémoré, construit, choisi et défini par les points communs qui relient les différentes individualités, le plus fort étant la douleur face à une situation du même ordre (vivre sous une dictature et avoir perdu sa famille lors d’exterminations, par exemple). Une fois cette reconnaissance faite, ce processus de remémoration va entraîner une certaine prise en charge par des institutions, la mémoire devient alors politique. Elle passe du cadre personnel et intime, à un cadre collectif, public, associatif et donc, politique.
Non moins fasciné par l’histoire que Paul Ricœur, Tzvetan Todorov s’écarte tout de même du caractère seulement philosophique et choisit de se concentrer, lui, non pas sur une épistémologie complète de l’histoire, mais « seulement », sur un point : l’abus de mémoire. Il rédigera 60 pages sur cette question, dans un ouvrage nommé sobrement « Les abus de la mémoire », présenté tout d’abord dans un congrès à Bruxelles, organisé par la fondation Auschwitz.
Todorov va expliquer la mémoire grâce à une distinction qu’il fait de deux termes différents : la mémoire littérale et la mémoire exemplaire.
La mémoire littérale va constamment s’inscrire dans un présent et se définit comme étant indépassable, comme si le deuil n’avait jamais réellement eu lieu et que la douleur était aussi difficile à supporter que pendant les événements traumatisants. C’est d’ailleurs un terme intéressant, « traumatisant », car il permet de comprendre qu’en effet, la mémoire littérale va confronter le protagoniste en tant que « victime » face à un traumatisme non-soigné. Cette mémoire-ci ne va pas réellement « servir » à la mémoire collective, justement, ni aux horreurs du présent. C’est une mémoire stérile, qui ne peut engendrer de leçons. En revanche, la mémoire exemplaire va, elle, permettre l’application d’un apprentissage incorporé grâce aux événements passés. Elle permet d’user du passé pour agir sur le présent.
Et c’est bien dans le présent que se jouent les plus gros enjeux de la mémoire : car se souvenir est une chose, mais comme le pensent Ricœur et Todorov, la mémoire est un outil qui permet d’agir (et non pas de régir) le présent. Pour cela, encore faut-il pouvoir se servir de la mémoire correctement. Alors, comment construisons-nous la mémoire et quels sont nos processus de création de mémoire collective?
- Comment construisons-nous la mémoire?
Le principe même de la mémoire, comme on a pu le voir précédemment, présuppose une construction. En effet, la mémoire n’est pas seulement le souvenir, c'est aussi une construction, un assemblage de remémorations et d’oublis, qui permettent de créer et de déterminer comment on se souvient des choses et comment on donne cela à voir sur la scène publique et politique.
Le processus de sélection des souvenirs peut être conscient ou inconscient à l’échelle individuelle, c’est ce qui permet de construire notre identité. On va personnellement choisir de se remémorer un événement, ou bien de l’oublier pour en mettre un autre en exergue. Toutefois, la mémoire reste principalement une réalisation collective, même quand il s’agit de se rappeler un événement de notre vie. C’est Maurice Halbwachs, dans « Les cadres sociaux de la mémoire » qui va dire que : « si nous examinons de quelle façon nous nous souvenons, nous reconnaîtrions que le plus grand nombre de nos souvenirs nous reviennent lorsque nos parents, amis, ou d'autres hommes nous les rappellent. » En effet, l’auteur souligne ici que bons nombres de souvenirs sont ravivés quand une personne ou une situation extérieure va les rappeler. C’est pourquoi la notion de « collectif » est présupposée quand on parle de mémoire. Ce que l’on peut alors nommer la « co-construction » de la mémoire va donc principalement désigner l’action de se remémorer des individualités ensemble, afin de définir une mémoire au plus près de la vérité, quand il s’agit d’événement collectifs et traumatisants, comme la guerre.
On pourrait penser, à lire tout cela, que la mémoire s’opposerait à l’oubli. Mais T. Todorov réfute cette idée en nous donnant à voir qu’en effet, « effacement » et « conservation » sont deux termes contradictoires, mais que la mémoire, elle, est ce qui va se jouer entre les deux. C’est-à-dire, donc, le processus de construction et surtout de sélection : « Conserver sans choisir n’est pas encore un travail de mémoire », nous dit-il. Car la mémoire n’est pas que remémoration, elle est aussi oubli. Intentionnel ou non, ce qu’on oublie est ce qu’on ne dit pas et cela propulse forcément d’autres souvenirs dans la lumière. La mémoire ne peut être que quand on sélectionne ce qui doit être oublié. La mémoire est une notion complexe mais qui est partie prenante de notre vie quotidienne, et de nos processus quotidiens. Le choix de mettre en avant certains souvenirs et d’en omettre d’autres va permettre la mise en avant d’une lecture précise de l’histoire. A titre exemplaire, quand nous pensons à la Seconde Guerre mondiale et que nous sommes le fruit de l’apprentissage par les livres d’histoires au collège, les premières images qui nous viennent en tête sont des clichés douloureux des camps de concentration, des expérimentations médicales, des défilés hitlériens, des rafles de Juifs et la Résistance. Car c’est ce qui est mis en avant quand on nous donne à voir des films tels que « Nuit et Brouillard » ou bien quand on regarde les images dans nos livres d’histoire. Cette construction s’est faite petit à petit dans les années qui suivirent les événements et aujourd’hui, doucement, beaucoup de centres d’Histoire tentent de déconstruire cette mémoire afin de montrer les temps longs de la guerre, la vie quotidienne, et donc d’effacer un peu cette vision sensationnaliste qui nous a été inculquée au fil de nos années d’études.
- Conclusion : Entre misérabilisme et sensationnalisme - la vision de la Seconde Guerre mondiale aujourd’hui
La mémoire telle qu’on nous la donne à voir n’est pas une chose en soi et qui va de soi. Entité complexe tiraillée entre la remémoration et l’oubli, elle est le fruit d’une construction pensée et imagée par les acteurs principaux : les associations, les musées, les politiques. Ce qu’on va donner à voir va être le pilier de connaissances et de références de nombreuses personnes, mais cela va surtout, je le pense, toucher les jeunes qui sont encore dans des structures dirigées par l’éducation nationale et l’histoire qu’ils écrivent : les collégiens et les lycéens. Modelés par les images extraordinaires et misérables des condamnés à mort dans les camps de concentration, on oubli de leur parler de la vie pendant la guerre. Cette vision reste alors implantée dans nos esprits car le but de ce misérabilisme est de toucher, de choquer, de graver dans nos imaginaires ce qui nous permettrait de ne pas reproduire les comportements passés. Malgré les initiatives tout à fait louables et nécessaires de nombreuses infrastructures, comme les centres historiques, qui tendent à montrer un temps plus long, une vie quotidienne à partir de témoins et en sélectionnant des archives qui vont souvent être des objets de tous les jours (machines à café, valises, instruments de cuisines, carnets, tickets de rationnements, livres scolaires…), l’éducation nationale n’est pas en accord avec cela. Les livres d’histoires mettent toujours en lumière les événements les plus marquants et ne parlent que très peu de la vie des sociétés touchées, de l’impact indirect de la guerre sur les populations, l’économie, la politique. Durant un échange avec la directrice du Centre de la Résistance et de la Déportation de Lyon, nous avons appris qu’un jour, un homme s’est plaint à elle en lui disant qu’il n’y avait pas de choses assez horribles dans leur exposition, pas assez de corps, de photos des camps, et qu’il était très déçu de ne pas pouvoir les montrer à son enfant.
On peut faire la différence entre « remémoration », qui est de se souvenir, et « utilisation » qui va être la manière dont le passé va impacter le présent.
Aujourd’hui, il est difficile de briser cette image sensationnaliste de la guerre bien qu’il y ait des structures qui s’y essayent. La mémoire est donc, comme nous pouvons le voir, le résultat d’une collaboration mais aussi un instrument utilisé pour façonner le souvenir et les imaginaires.
Bibliographie
- Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire, Albin Michel, 1994.
- Todorov, Tzvetan. Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995.
- Ricœur, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris, Edition du Seuil, 2000.